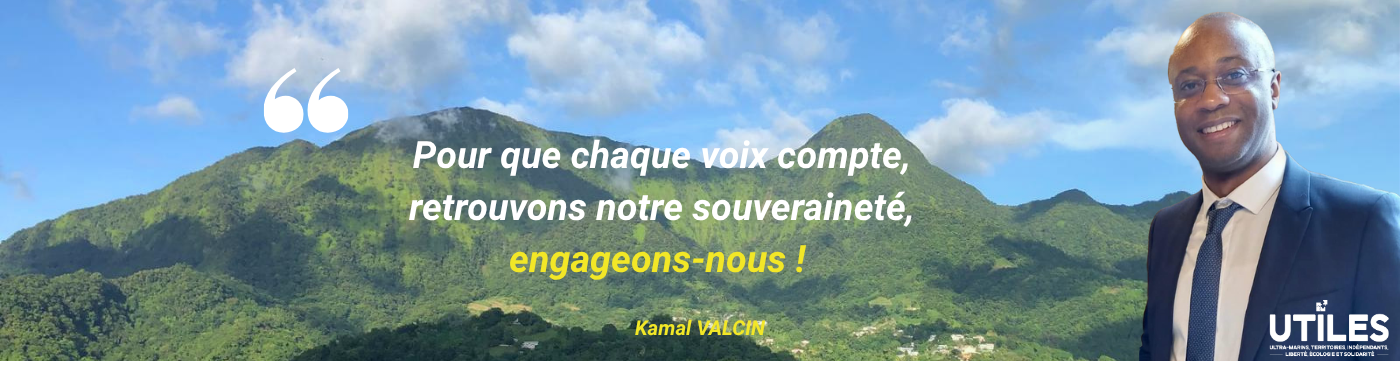La Martinique vit sous la menace constante de catastrophes naturelles majeures : cyclones, séismes et, surtout, le risque volcanique de la Montagne Pelée, classée parmi les systèmes volcanologiques les plus dangereux au monde. Malgré cette réalité implacable, le territoire affiche une vulnérabilité critique, exacerbée par une préparation insuffisante et un déficit de coordination politique et régionale.
La Fragilité Face au Risque Volcanique
Le risque de la Montagne Pelée ne relève pas de la théorie. L’éruption de 1902 reste la catastrophe naturelle la plus meurtrière du XXe siècle en France. Aujourd’hui, on estime que près de 38 000 personnes vivent dans les zones les plus exposées au nord, soumises à des aléas majeurs tels que les nuées ardentes ou les lahars (coulées de boue volcanique).
Si des Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRN), notamment volcaniques, existent pour encadrer l’urbanisme et définir des zones de danger, leur efficacité est limitée par le développement humain non maîtrisé sur les flancs du volcan. De plus, les enquêtes menées auprès des populations révèlent souvent un manque de connaissance des phénomènes volcaniques et une perte de la mémoire des événements passés, signe d’une culture du risque qui reste à consolider.
Le défi logistique en cas d’alerte maximale est colossal : la relocalisation de dizaines de milliers de personnes vers les zones centre et sud, déjà saturées, se heurte à des problématiques d’hébergement de longue durée, dans un contexte de forte densité de population sur une petite île. Les plans d’évacuation, bien qu’élaborés (Plan de Secours Spécialisé Volcan), exigent une répétition et une adhésion totale des acteurs et de la population, qui ne sont pas toujours au rendez-vous.
Une Coordination Politique à Renforcer
Face à de tels enjeux, la gouvernance du risque doit être irréprochable. Or, le pilotage de la politique de prévention en Martinique est souvent pointé du doigt pour des retards dans l’action et une complexité administrative qui ralentit les projets cruciaux, notamment ceux visant à réduire la vulnérabilité des constructions (Plan Séisme Antilles) ou à améliorer la gestion des déchets (facteur de vulnérabilité après catastrophe).
Un fossé semble persister entre la production de documents techniques (PPRN, DICRIM – Document d’Information Communal sur les RIsques Majeurs, dispositif ORSEC) et leur application concrète sur le terrain. Les autorités locales (mairies) et les services de l’État (Préfecture, DEAL) doivent travailler de concert, de manière plus fluide et transparente, pour que les consignes de sécurité, les zones refuges, et les voies d’évacuation soient non seulement définies, mais connues et régulièrement exercées par la population.
L’Urgence d’une Coopération Régionale Active
La dimension insulaire de la Martinique et sa position au sein de l’Arc Antillais exigent une vision et une coordination qui dépassent les frontières administratives du département. Si des initiatives de coopération existent (programmes INTERREG, Plateforme d’intervention Régionale Amériques-Caraïbes de la Croix-Rouge – PIRAC), elles se concentrent souvent sur l’aide post-catastrophe (réponse d’urgence) et mériteraient d’être systématisées dans la prévention et la planification stratégique.
En cas d’éruption volcanique majeure, l’île devra inévitablement compter sur l’aide de ses voisins de la Caraïbe et des Antilles françaises (Guadeloupe). Pourtant, l’intégration des plans d’urgence inter-îles, la mutualisation des moyens logistiques (transport maritime et aérien pour les évacuations de masse ou l’acheminement de l’aide), et l’harmonisation des procédures d’alerte entre les îles voisines (soumises aux mêmes aléas cycloniques et sismiques) ne semblent pas avoir atteint le niveau d’efficacité requis. Le rapport de la Cour des Comptes sur la prévention des catastrophes en Outre-mer souligne d’ailleurs la nécessité d’accélérer les simulations régionalisées et de structurer davantage ces politiques interministérielles.
Conclusion : Le Coût de l’Oubli
L’impréparation n’est pas une fatalité, c’est une décision politique par défaut. La Martinique ne peut se permettre d’attendre la prochaine crise pour réagir. L’histoire a montré le coût humain exorbitant de l’oubli. Il est impératif :
- De renforcer la culture du risque auprès de la population par des campagnes continues et des exercices réguliers.
- De garantir la stricte application des PPRN pour stopper l’urbanisation des zones de danger.
- De fluidifier la chaîne de commandement et d’opération entre l’État et les collectivités territoriales.
- D’institutionnaliser une coordination régionale de prévention et de réponse aux catastrophes, pour que la solidarité des îles soit un pilier de la sécurité collective, et non un simple vœu pieux.
L’heure est à l’action, car la nature, elle, ne connaît pas d’atermoiements.
Kamal VALCIN – Citoyens engagés.
Soyons UTILES pour notre pays