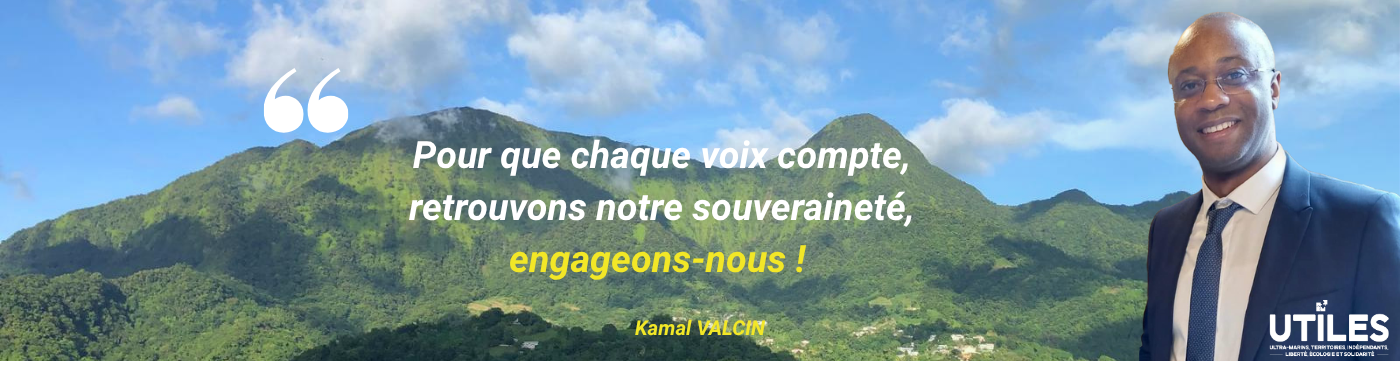Le malaise est palpable, souvent murmuré, mais rarement dénoncé publiquement. En Martinique, la reconnaissance sociale est trop souvent une équation simple et cruelle : titre élevé = valeur, travail de terrain = invisibilité. Cette obsession pour la position sociale ou le statut professionnel conféré par un diplôme ou une fonction est un véritable anachronisme, une aberration sociale qui bride notre développement et fracture notre communauté.
Le poids d’une hiérarchie héritée
L’histoire des Antilles est celle de la hiérarchie. Dans une société marquée par l’esclavage et la colonisation, l’accès à certaines professions, notamment au sein de l’administration ou dans les professions libérales, fut longtemps un marqueur d’ascension sociale et d’émancipation face au travail contraint. Si l’aspiration à la réussite est légitime, l’excès de cette valorisation a créé une société du titre qui ne juge plus l’individu sur son mérite, son utilité ou la qualité de son travail, mais sur l’étiquette qu’il porte.
On ne salue pas le dévouement d’un agriculteur qui nourrit l’île, ni l’expertise d’un artisan qui bâtit nos maisons, ni même la résilience d’un soignant de première ligne. On ne célèbre que le « Monsieur le » ou le « Madame la », le statut. Ce n’est pas l’effort qui est valorisé, mais l’apparence de la réussite.
L’ironie d’une société qui méprise son socle
Le paradoxe est d’autant plus frappant que nous sommes une île qui peine à atteindre l’autonomie. Nous avons besoin, plus que jamais, d’une économie réelle : des agriculteurs qui diversifient nos cultures, des techniciens pour réparer nos infrastructures, des artisans pour créer un savoir-faire local fort.
Or, ce sont précisément ces métiers qui sont systématiquement dévalorisés et stigmatisés. On pousse la jeunesse vers des carrières de bureau ou la fonction publique, souvent par défaut, car la perspective de devenir maçon, pêcheur, ou cuisinier est socialement perçue comme un échec, une voie de garage.
Le résultat ? Un manque cruel de main-d’œuvre qualifiée dans des secteurs vitaux, une fuite des talents qui n’osent pas entreprendre localement sans le « bon » diplôme, et une dépendance accrue aux importations et aux cadres extérieurs. Cette attitude sociale est un sabotage silencieux de notre propre potentiel.
Sortir de la tyrannie des apparences
Cette aberration n’est pas seulement une question de snobisme ; c’est un frein structurel à la cohésion sociale et à la diversification économique. Elle installe un ressentiment entre ceux qui « réussissent » selon les critères obsolètes du statut et ceux qui, sur le terrain, font tourner le pays.
Il est temps, et il est urgent, d’opérer une révolution des valeurs en Martinique.
Nous devons enseigner à nos enfants et nous rappeler à nous-mêmes que la véritable valeur sociale ne réside pas dans le nom du métier, mais dans sa nécessité et dans la qualité de l’effort qu’il demande.
- Valorisons l’entrepreneur qui prend des risques.
- Respectons l’ouvrier qui construit.
- Célébrons le créateur qui innove, qu’il soit diplômé d’une grande école ou autodidacte.
L’île ne se développera que lorsque nous aurons fait la paix avec l’idée que le travail, quel qu’il soit, est digne de respect et de reconnaissance. La Martinique a besoin de tous ses talents, pas seulement de ceux qui se conforment à l’image surannée du « bon poste ». C’est seulement en réaffirmant la dignité de chaque métier que nous pourrons bâtir une société plus juste, plus unie et véritablement prospère.
Et vous, quelle place donnez-vous à l’utilité du travail par rapport à son titre ?
Kamal VALCIN & Alizée BALTUS – Citoyens engagés.
Soyons UTILES pour notre pays