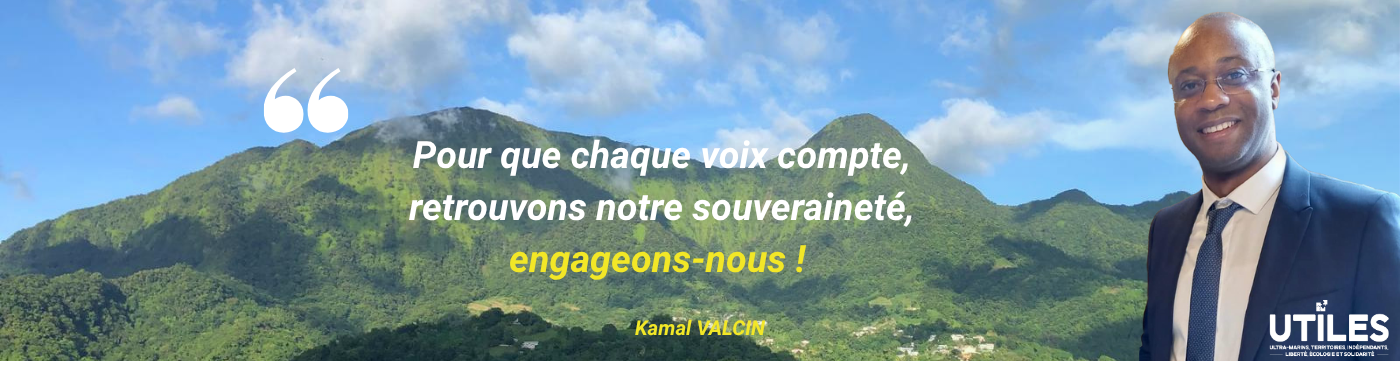La Martinique, île paradisiaque des Antilles, est confrontée à une crise sanitaire et environnementale silencieuse mais dévastatrice : la contamination de son eau par les PFAS, ou substances per- et polyfluoroalkylées. Ces « produits chimiques éternels », en raison de leur persistance dans l’environnement et l’organisme, représentent une menace majeure pour la santé publique et les écosystèmes insulaires. Les conséquences de cette contamination sont multiples et alarmantes, exigeant une action immédiate et concertée.
Une contamination alarmante et généralisée
Les PFAS ont été largement utilisés dans l’industrie pour leurs propriétés antiadhésives et imperméabilisantes, se retrouvant dans des produits de consommation courante comme les textiles, les emballages alimentaires, les ustensiles de cuisine et même les mousses anti-incendie. En Martinique, la principale source de contamination est l’épandage intensif de chlordécone, un pesticide organochloré, qui a malheureusement introduit des PFAS dans le cycle de l’eau. Des études récentes ont révélé une présence quasi généralisée de ces substances dans les réseaux de distribution d’eau potable de l’île.
Les chiffres sont préoccupants. Selon un rapport de l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Martinique, des analyses menées en 2022 ont montré que plus de 90% des points de prélèvement d’eau potable présentaient des traces de PFAS. Plus alarmant encore, environ 25% de ces points dépassaient les seuils sanitaires provisoires fixés par l’Union Européenne, qui sont de 100 nanogrammes par litre (ng/L) pour la somme de 20 PFAS et de 4 ng/L pour la somme de PFOA et PFOS. Dans certaines zones, les concentrations ont même atteint jusqu’à 300 ng/L, soit trois fois le seuil provisoire.
Ces chiffres, bien que n’étant que des instantanés, témoignent d’une imprégnation profonde et durable de la ressource en eau. La persistance des PFAS signifie que même si les sources d’émission étaient stoppées aujourd’hui, la décontamination prendrait des décennies, voire des siècles.
Des conséquences sanitaires et environnementales insidieuses
Les conséquences de cette exposition chronique aux PFAS sont multiples et souvent insidieuses. De nombreuses études scientifiques ont établi un lien entre l’exposition aux PFAS et divers problèmes de santé, notamment :
- Des troubles endocriniens : perturbation de la fonction thyroïdienne, impact sur le développement et la reproduction.
- Des effets sur le système immunitaire : diminution de la réponse vaccinale, augmentation de la susceptibilité aux infections.
- Des risques accrus de certains cancers : notamment du rein et des testicules.
- Des problèmes de développement chez l’enfant : faible poids à la naissance, retards de développement.
- Des maladies cardiovasculaires et métaboliques : augmentation du cholestérol, hypertension.
En Martinique, où la population est déjà confrontée aux séquelles de la chlordécone, l’ajout des PFAS vient alourdir un fardeau sanitaire déjà lourd.
Sur le plan environnemental, la contamination des eaux de surface et souterraines affecte non seulement l’eau potable mais aussi les écosystèmes aquatiques, la faune et la flore. Les PFAS s’accumulent dans la chaîne alimentaire, menaçant la biodiversité et, à terme, la sécurité alimentaire de l’île.
Urgence d’une action globale et coordonnée
Face à l’ampleur de cette crise, une action urgente et multidimensionnelle est impérative.
- Renforcement des contrôles et de la surveillance : Il est crucial d’intensifier les analyses des PFAS dans l’eau potable, mais aussi dans les sols, les sédiments, les denrées alimentaires et chez la population, afin d’établir une cartographie précise de la contamination et de ses impacts.
- Mise en place de solutions de traitement de l’eau : Des technologies de filtration avancées, telles que le charbon actif granulé ou les membranes d’osmose inverse, doivent être déployées massivement dans les usines de traitement pour éliminer les PFAS de l’eau potable. Des investissements significatifs sont nécessaires pour moderniser les infrastructures existantes.
- Information et sensibilisation de la population : Il est primordial d’informer la population martiniquaise sur les risques liés aux PFAS, les gestes de prévention et les mesures prises par les autorités. La transparence et la confiance sont essentielles.
- Recherche et développement : Soutenir la recherche pour mieux comprendre les spécificités de la contamination aux PFAS en milieu tropical, évaluer leurs impacts sanitaires spécifiques sur la population martiniquaise, et développer des solutions de décontamination innovantes.
- Cadre réglementaire strict : Exiger une réglementation plus stricte au niveau national et européen concernant la fabrication, l’utilisation et l’élimination des PFAS, avec l’objectif à terme d’une interdiction totale de ces substances.
- Soutien financier : Des fonds dédiés et des mécanismes de compensation doivent être mis en place pour soutenir la Martinique dans ses efforts de dépollution et d’accompagnement des populations affectées.
La Martinique est un territoire d’expérimentation pour la gestion des crises environnementales et sanitaires complexes. La lutte contre les PFAS est un défi de taille, mais elle représente aussi une opportunité de construire un avenir plus sain et plus durable pour l’île. C’est un impératif de santé publique, un devoir envers les générations futures et une question de justice environnementale. Il est temps d’agir, et d’agir vite.
Kamal VALCIN & Alizée BALTUS – Citoyens engagés.
Soyons UTILES pour notre pays