
Le nom de Victor Schoelcher est indissociable de l’abolition de l’esclavage en France. Le 27 avril 1848, sous l’impulsion de cet homme politique et journaliste, le gouvernement provisoire de la Deuxième (IIe) République signait le décret d’abolition. Pour beaucoup, il est le grand artisan de la liberté, une figure héroïque dont les restes reposent aujourd’hui au Panthéon. Mais cette image, gravée dans la mémoire collective, ne serait-elle pas une simplification excessive, voire une imposture historique ?
L’histoire, comme souvent, est plus nuancée. Réduire l’abolition à l’action d’un seul homme, aussi déterminé fût-il, c’est ignorer des décennies de luttes et de résistances. Des esclaves eux-mêmes, aux Antilles comme dans l’océan Indien, se sont battus, ont fui, se sont révoltés. Ces insurrections, ces actes de courage, ont créé un climat de tension qui a rendu l’esclavage intenable pour les colons et a contraint les autorités françaises à agir. L’abolition n’était pas un cadeau fait par un homme blanc bienveillant, mais la conséquence inévitable d’une résistance acharnée.
Schoelcher, loin d’être un révolutionnaire isolé, s’inscrivait dans un mouvement abolitionniste plus large. Certes, il a été une figure de proue, mais il a bénéficié du travail de ses prédécesseurs et de ses contemporains. Des figures comme l’abbé Grégoire, mais aussi et surtout des voix moins connues, des militants, des écrivains et des penseurs qui ont œuvré pendant des années pour dénoncer l’inhumanité de ce système.
Mais c’est la question des indemnisations qui soulève le plus de critiques. Le décret de 1848, tout en libérant les esclaves, a prévu d’indemniser les colons, ceux-là mêmes qui s’étaient enrichis sur le travail forcé. C’est ici que Schoelcher révèle une facette moins glorieuse de son action. Loin de s’opposer à ce principe, il l’a défendu, arguant que cela était nécessaire pour la stabilité économique des colonies. En d’autres termes, la liberté des uns a été monnayée pour assurer la richesse des autres. Cette décision a légitimé un système de spoliation et a laissé des millions de personnes libérées sans terre, sans ressources, les rendant dépendantes du bon vouloir de leurs anciens maîtres. L’abolition, loin d’être un point final, a marqué le début d’une nouvelle forme d’injustice sociale.
La mémoire de Victor Schoelcher doit être réévaluée. Le considérer comme le « libérateur » est une narration simpliste qui efface le courage des esclaves et minimise les complexités de l’histoire. Il a été un acteur important, un homme de son temps, avec ses contradictions et ses compromis. Mais la liberté n’a pas été accordée, elle a été arrachée. En continuant de le vénérer comme le seul héros de cette histoire, on risque d’oublier que les véritables artisans de l’abolition ne sont pas ceux qui ont signé des décrets, mais ceux qui, dans la souffrance et la lutte, ont rendu la liberté possible.
Kamal VALCIN & Alizée BALTUS – Citoyens engagés.
Soyons UTILES pour notre pays
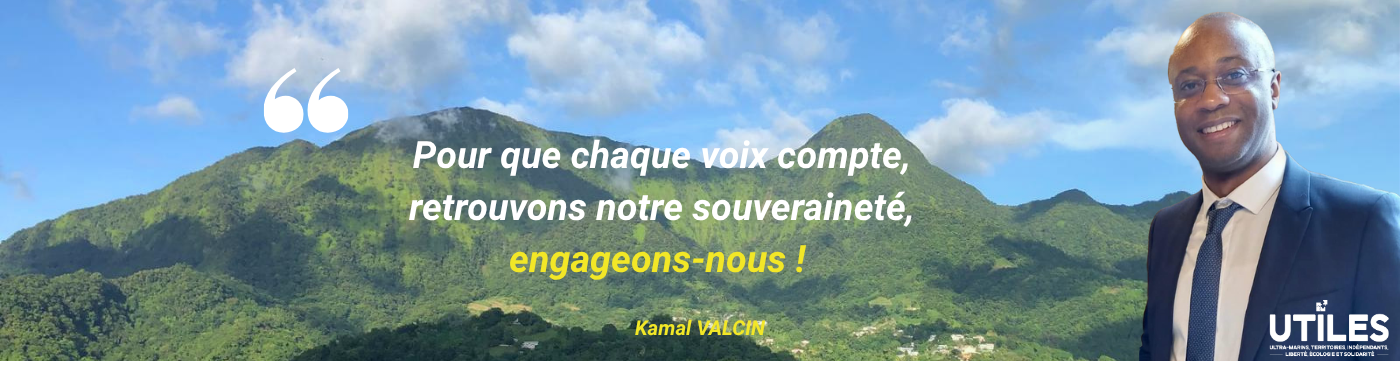

Il est absolument important d’en prendre conscience dans notre époque vu que cette liberté a été arrachée également par la force des coupes/coupes!
Merci à Kamal et Alizée de nous éveiller sur ce point sensible de notre histoire !